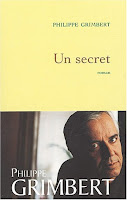Mise en abyme dans le fond et la forme
« Il serait lui-même dans le tableau, à la manière de ces peintres de la Renaissance qui se réservaient toujours une place minuscule au milieu de la foule des vassaux, des soldats, des évêques ou des marchands » (Chapitre LI).
Il s’agit là du rêve du peintre valène devant son tableau mais aussi du désir de l’auteur face à son œuvre ; jeu d’apparitions, de disparitions au gré d’une mosaïque dont le puzzle de Bartlebooth n’est qu’une éblouissante métaphore.
Le roman commence en juin 1975 (le 23) et se compose de quatre vingt dix-neuf chapitres (et non pas cent), repartis dans six parties. Il montre la vie de centaines d’habitants dans les scènes les plus banales du quotidien. Le lecteur entre ainsi dans tous les appartements de l’immeuble, dans toutes pièces, passant du salon à la chambre, de la cuisine à la salle de bains, des escaliers à la cave, et pénètre dans la vie de chacun. Il observe un monde en réduction et assiste à une sorte de comédie humaine, riche en événements parfois étranges, parfois anodins.
L ‘oeuvre est audacieuse, pleine de secrets, de nombres, de codes et d’intrigues en apparence difficiles à percer. A ce propos on notera que de nombreuses recherches ont été menées sur ce livre afin de venir à bout de des énigmes qu’il pose. Des programmes informatiques ont même été créés à partir des textes de Perec.
L’image du puzzle se superpose, c’est l’histoire centrale de Bartlebooth et Winckler, bien sûr, dont le projet circulaire a pour but de s’auto annuler (voir entrée blog intitulée « oeuvre romanesque ou projet scientifique ») mais ce sont aussi ces morceaux d’histoires dans l’histoire, ces mises en abyme aux reflets infinis, ces intrigues multiples, digressions permanentes, références et clins d’oeil nombreux à d’autres auteurs tels que Flaubert, Jules Vernes, Queneau, Proust, Joyce, Borges ou bien Perec, lui-même. Dans ce puzzle géant il y aurait matière à plusieurs livres ce qui pourrait expliquer le sous titre «Romans » avec un « s ». La vie mode d’emploi donne au lecteur des instructions comme pour l’usage d’une machine, d’un outil ou bien encore lui propose un guide spirituel (sorte de manuel de la vie pouvant faire référence à la torah).
De nombreuses interprétations ont été faites, certaines philosophiques, d’autres sociales ou encore psychanalytiques (le psychisme humain vu à l’image de l’immeuble rempli de bric-à-brac, de fantasmes, d’obsessions, de souvenirs, de légendes, de citations, d’images, de bribes hétéroclites de savoir, d’entreprises grandioses ou minables. On note ici d’ailleurs l’histoire amusante du centième chapitre mangé par la petite fille «qui mord dans un coin de son petit beurre Lu » – et raison pour laquelle la cave dans le coin inférieur gauche de l’immeuble n’est pas décrite).
Le style du roman est très descriptif. Il fait souvent penser à la technique cinématographique (on pense à Wim Wenders dans Les ailes du désir ou bien encore Krzysztof Kieslowski dans Le Décalogue). Perec s’est beaucoup intéressé au cinéma et a tourné quelques courts métrages.
Ecriture de la contrainte
Le livre est basé sur la technique de la contrainte (cf. Oulipo). Perec est un véritable sportif des lettres, un athlète ou équilibriste qui jongle avec les vingt-six lettres de l’alphabet. La liste des contraintes ou structures formelles utilisées par Perec est impressionnante, en voici seulement quelques exemples :
• Lipogrammes : disparition d’une lettre (ex. La disparition)
• Palindromes : peuvent être lus de gauche à droite ou de droite à gauche
• Allitérations : répétition de sons identiques
• Anagrammes : recréer un mot à partir d’un autre/permutation des lettres (ex. Aimer pour Marie)
• Formules mathématiques et structures formelles telles que la polygraphie du cavalier, le bi-carré latin orthogonal d’ordre 10, la pseudo-quenine d’ordre 10 (Texte donné en exemple pour le bi-carré latin d’ordre 3 selon les principes de l’Oulipo)
Ces structures formelles dans La vie mode d’emploi définissent le déplacement et le contenu des pièces.
• Homonymes : mots de prononciation identiques mais de sens différents
• Homophones : mots de même prononciation (ex. haut et eau)
• Homographes : mots de même orthographe mais pouvant avoir une signification différente
• Hétéronymes : qui se référent au même hyperonyme mais qui ne sont pas synonymes (ex. pantoufle et babouche par rapport à chaussure)
Le cahier des charges, laboratoire de Perec ou code génétique et programme d’écriture de l’œuvre, est paru après sa mort révélant toutes les contraintes auxquelles l’auteur, en bon Oulipien, s’est plié pour écrire son roman. Cela rappelle ce qu’Italo Calvino nommait « La machine littérature » (cf. aussi Das Glasperlenspiel/Le jeu des perles de verre d’Hermann Hesse).
Quel rôle joue la contrainte ? Quels sont ses objectifs?
La contrainte permet de :
• stimuler (elle relance l’imagination)
• inventer (elle permet d’innover/d’être moderne)
• démystifier (elle banalise et prive de son mystère)
Mais la plus grande contrainte reste certainement celle de ne pas en avoir (cf. angoisse de la feuille blanche /Mallarmé).