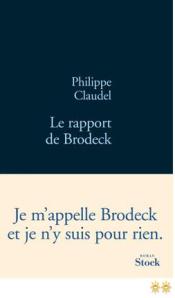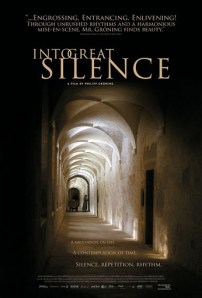- Bonjour Benjamin, je suis heureuse de vous accueillir aujourd’hui dans le cadre de l’AF pour cette conversation.
Vous êtes Français, originaire de Bordeaux, où vous avez grandi. Après des études de lettres modernes et de philosophie à la Sorbonne et à l’École normale supérieure, vous êtes devenu lecteur de français à Amherst College dans le Massachusetts. C’est là que vous êtes tombé amoureux des états Unis et vous avez décidé de vous y installer en 2010.
Vous êtes docteur de l’université Yale et professeur associé à l’université Ohio State où vous enseignez la littérature française du 18e siècle et la création littéraire. Vous êtes aussi directeur du Centre d’excellence de l’université Ohio State dont le but consiste à promouvoir la culture française et francophone aux États-Unis.
C’est en qualité d’écrivain que nous vous recevons aujourd’hui car vous avez publié huit livres en France et aux États-Unis, parmi lesquels Père et Fils (Gallimard, 2011), American Pandemonium (Gallimard, 2016), L’Amérique posthume (Classique Garnier, 2019), Les paradoxes de la postérité(Minuit, 2019) et L’île de la Sentinelle qui vient de paraître chez Gallimard en février 2022.
Comme le titre l’indique, votre roman porte sur l’Île de la sentinelle, située dans l’océan Indien (baie du Bengale) et peuplée par une des dernières tribus indigènes entièrement coupées du monde moderne ainsi que sur la vie de deux amis Krish et Markus. Krish, d’origine indienne et Markus, jeune Américain fortuné et brillant, font connaissance lors de leurs études à Yale et partagent rapidement la même fascination pour l’île interdite, fascination qui sera le nœud de l’intrigue.
Qu’est-ce qui vous a fait prendre la plume sur ce sujet ? Pourquoi l’île de la Sentinelle ?
Ce qui m’a fasciné dans l’île de la Sentinelle, c’est sa position à la fin de ce qu’on peut appeler l’âge des grandes découvertes. Au 16e siècle commence l’entreprise occidentale de découverte du monde qui produit le recensement de plus en plus exhaustif de la planète. Petit à petit la mention « terra incognita » disparaît des cartes ; petit à petit le désir de voyager disparaît aussi car à mesure qu’on découvre le monde, le désir de découvrir de nouveaux espaces se réduit. Et ce qui arrive tout à la fin de ce très long processus d’arpentage, de découverte du monde, c’est l’île de la Sentinelle…le dernier espace sur la planète qui conserve une très grande quantité de mystères.
On sait très peu de choses sur l’île de la Sentinelle, sur son organisation géographique, sur ce qui se trouve sur l’île elle-même. Juste une poignée d’anthropologues ont pu s’y rendre dans les dernières décennies. L’île la Sentinelle est maintenant absolument interdite. Il y a un cordon de sécurité maintenu en permanence par la marine indienne pour empêcher les incursions étrangères. Et bien entendu, ce qui la rend fascinante, c’est son peuple, dont rien ou presque n’est connu. On sait des Sentinelles essentiellement ce qu’on ignore : leur langue, leurs croyances religieuses. On sait juste une chose avec certitude, c’est que les Sentinelles ne veulent pas de notre présence. Ils le montrent d’une manière éloquente en repoussant la venue de tous les étrangers. Ce qui m’a fasciné dans cette île, c’est sa dimension de dernier territoire de l’aventure humaine quand le reste du monde a été arpenté, parcouru, connu, identifié. Comme je le disais dans un passage, tout peut être observé de nos jours par l’intermédiaire de Google Maps et grâce aux moyens techniques dont nous disposons. Il reste cependant ce fragment ; il ne reste justement à notre époque plus que lui. C’est ce qui rend à mon sens cet espace fascinant.
- Vous avez dû, j’imagine, faire beaucoup de recherches, comment avez-vous procédé pour apprendre tout ce qu’on découvre en vous lisant ?
Je me suis appuyé sur ma formation universitaire et j’ai pris cette île et son peuple comme objet intellectuel à étudier. Même si j’ai dit à l’instant que très peu de choses sont connues au sujet des Sentinelles ; quand on creuse un petit peu on se rend compte qu’en vérité, il y a eu des spécialistes qui se sont intéressés à eux d’assez prêt et il existe des ouvrages anthropologiques écrits à partir des années 1990. Pour une brève période le gouvernement indien a autorisé des missions régulières sur l’île de la Sentinelle afin d’essayer d’établir un contact avec son peuple. C’est ainsi qu’un contact a été établi avec des tribus de l’Archipel des Andamans : les Onges et les Jarawas. Je me suis intéressé à cette île par l’intermédiaire de ces ouvrages anthropologiques sérieux, je pense notamment aux ouvrages de Triloknath Pandit. Ce qui m’a également fasciné, c’est la représentation des Sentinelles dans le monde, dans les médias – il s’agit là d’une approche plus populaire où on les représente en les caricaturant, les stéréotypant. Je me suis donc emparé de tous les documents qui existent et me suis inspiré des travaux sérieux sur le sujet afin de dépasser cette représentation caricaturale des sentinelles comme peuple soi-disant barbare, sauvage, voire cannibale.
- Vous êtes-vous rendu vous-même dans les Andamans pour connaître ces peuples que vous évoquez : les Onges et les Jarawas ?
Non, je n’ai eu ni l’occasion ni le besoin de m’y rendre. Je dirais qu’il y a une grande facilité à s’imprégner d’images, de couleurs, de sensations, notamment par l’intermédiaire de toutes les photos qu’on peut trouver sur Internet. Ce qui aussi m’a permis de ne pas éprouver le besoin de me rendre sur place, c’est un documentaire absolument magnifique intitulé « Nous sommes l’humanité » du journaliste, Alexandre Dereims. Ce documentaire m’a beaucoup influencé et je le mentionne à la fin du roman. Dereims a eu l’occasion de se rendre dans les Andamans, dans la réserve des Jarawas, une tribu à laquelle personne n’a normalement accès. Il a réussi à contourner l’interdiction et est arrivé à les rencontrer, à leur donner la parole. Ce documentaire m’a apporté beaucoup d’images et de contenus que j’ai pu ensuite réinvestir dans le livre. Et de toutes façons, il est impossible de s’approcher de l’île de la Sentinelle, c’est interdit et tout à fait illégal. Aller chez eux, c’est aussi les mettre en danger car nous sommes porteurs de microbes qui pourraient facilement détruire cette population dont on ne connaît pas le chiffre exact, quelques dizaines…deux cents personnes peut-être.
- Vous évoquez l’histoire de John Chau, jeune évangéliste américain qui a enfreint l’interdiction et est allé sur l’île pour y porter la bonne parole ; il souhaitait évangéliser les Sentinelles. Cela s’est très mal fini et vous relatez dans votre roman cet événement tragique survenu en novembre 2018, pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, effectivement j’en parle dans une section du livre. Le roman est construit de telle sorte qu’il y a dans les deux premières parties une alternance entre les chapitres qui sont consacrés à l’histoire de Krish et Markus (les deux personnages centraux) et ceux consacrés à ces rencontres épisodiques entre l’occident et les Sentinelles. L’un des chapitres les plus développés du livre parle de ce missionnaire que vous évoquiez : John Chau. Très jeune, à l’âge de dix-sept ans seulement, au retour d’un voyage au Mexique où il avait participé à la construction d’une école dans une mission évangélique, John Chau s’est mis en tête d’aller sur l’île de la Sentinelle pour apporter la bonne parole à ces derniers. Toute son existence s’est construite autour de ce but. Étudiant dans une université évangélique d’Oklahoma, il s’est formé à la médecine en urgence ainsi qu’aux techniques permettant de prendre contact avec des peuples qui n’ont jamais été contactés. Après plusieurs voyages de repérages, il s’est rendu en 2018 sur l’Archipel des Andamans, avec l’objectif d’aller sur l’île de la Sentinelle. Objectif qu’il est finalement arrivé à remplir. Il a fait un premier séjour très bref sur l’île, les Sentinelles lui ayant fait signe clairement qu’il n’était pas le bienvenu ; puis il est retourné une deuxième fois et a failli se faire tuer. Enfin, la troisième fois, il s’est effectivement fait tuer par les Sentinelles. Cette histoire a eu une importance dans la genèse du roman pour différentes raisons. J’avais plus ou moins renoncé à écrire ce texte, puis l’histoire tragique de John Allen Chau a relancé mon intérêt pour ce peuple. C’est donc l’évènement déterminant qui a enclenché la genèse du texte. La rédaction a commencé en janvier 2019 et j’ai fini le livre en 2021.
- Donc si je comprends bien, le projet d’écrire sur les Sentinelles était là avant 2019, vous ne saviez pas exactement comment le faire et c’est cette tragédie qui vous a fait revenir sur ce projet initial ?
Oui, j’ai tendance à beaucoup échouer quand j’écris. Mes livres ont tendance à parler d’aventures mais selon moi l’écriture elle-même est une aventure. Et une aventure, très souvent, cela échoue, il y a des arrêts, des moments catastrophiques. J’avais fait plusieurs tentatives pour écrire ce roman mais n’avais jamais trouvé la bonne approche pour le faire. Cette histoire m’a interpellé et montré qu’il existait des gens dans le monde qui pouvaient éprouver une fascination au point de se mettre en danger pour elle et en l’occurrence risquer leur vie pour fouler la grève de cette île interdite.
- Dans votre roman on découvre deux histoires qui s’emboîtent, d’un chapitre à l’autre, et finissent par se rejoindre pour bientôt n’en faire qu’une :
L’histoire de Krish et de Markus – c’est la partie fictionnelle dans laquelle il est question non seulement de montrer leur relation ambiguë entre amour-haine mais aussi de résoudre un mystère – mystère qui ne nous sera révélé qu’à l’issue du roman, et
L’histoire de l’île de la sentinelle, depuis ses origines il y a 60 mille ans – un récit donc de faits historiques montrant les stéréotypes, le racisme, la violence à laquelle elle est exposée au cours du temps. - Pourquoi avez-vous choisi ce modèle d’emboîtement des deux narrations ? Est-ce justement lorsque vous êtes revenus sur l’histoire de John Chau que vous avez fait ce choix d’alternance ?
A l’origine mon intention était de faire un récit emboîté, c’est à dire avoir une première partie purement fictionnelle puis inclure ensuite un long passage sur les moments de contacts entre l’occident et l’île de la Sentinelle. Mais je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup à dire et que cela ferait exploser la structure de mon roman car l’interruption de la partie fictionnelle serait trop longue. J’ai alors lu un texte qui m’a beaucoup influencé, d’un de mes romanciers préférés, l’auteur japonais Haruki Murakami. Dans La fin du monde, un de ses romans préférés d’ailleurs, il y a un phénomène d’alternance entre deux histoires : une ancrée dans la réalité référentielle de Tokyo et une autre plus dans la tradition du réalisme magique nippon dont Murakami est l’un des exemples parfaits. Ce phénomène d’alternance m’a donné l’idée d’adopter quelque chose de similaire, de jouer sur l’alternance entre les deux parties du récit : la partie fictionnelle et la partie documentaire que vous évoquiez.
- Krish, étudiant en anthropologie, écrit sa thèse, Markus, étudiant en littérature rédige un mémoire sur Joseph Conrad et entame en parallèle l’écriture d’une fiction sur l’île de la sentinelle. Sans oublier que le roman que nous lisons, nous lecteurs, est celui de Krish, (à la fois personnage principal et narrateur) qui âgé, malade et au seuil de la mort prend la plus plume pour nous conter son histoire.
On comprend que l’acte d’écriture tient une part importante dans le roman. Pourquoi avoir voulu créer cet effet d’écho de l’écriture, cet effet de miroir ? L’écriture/la littérature serait-elle un moyen de s’ancrer dans le réel, de lutter contre l’évanescence et la finitude ?
Il y a effectivement une réflexion aussi sur l’écriture du roman ; je dirais que tout écrivain à notre époque écrit après Proust et après cet immense roman qui réfléchit sur l’acte même de l’écriture. Cette dimension post moderne du roman qui réfléchit à sa propre écriture m’a intéressé. Un personnage, Markus, écrit un roman qui s’appelle L’île de la Sentinelle. C’est un roman raté ; Markus est un écrivain raté. Il essaie de produire une œuvre mais, par dilettantisme ou par faiblesse, il n’y parvient jamais réellement. Il y a cette angoisse de ma part de réfléchir sur l’acte même de l’écriture du roman dans le roman, d’essayer de dépasser le spectre de l’échec du roman. J’espère que L’île de la Sentinelle arrive à transcender l’échec de L’île de la sentinelle fictive dont il est question dans le livre.
- Vous ouvrez chaque partie du roman (et il y en a trois) par une citation de Joseph Conrad. Conrad est aussi l’auteur sur lequel écrit Markus, cet écrivain raté que nous évoquions, car c’est le sujet de sa thèse de littérature à Yale. Pourquoi avoir choisi Conrad ? Est-ce pour son contact avec les populations lointaines ou parce qu’il évoque les profondeurs et les ambiguïtés de l’âme humaine ?
Les deux. A vrai dire, la raison précise pour laquelle j’ai inclus ainsi l’œuvre de Conrad est liée à un article magnifique du journaliste Adam Goodheart The last island of the savages. Ce journaliste américain y raconte sa propre tentative au début des années 2000 pour essayer de se rendre sur l’île de la Sentinelle. Dans ce texte, il se place lui-même sous l’égide de Joseph Conrad. L’allusion à Conrad dans cet article m’a amené à relire l’œuvre de cet auteur, bien sûr Au cœur des ténèbres mais aussi Lord Jim, qui est à mon sens son grand roman. Conrad réfléchit sur l’humanité en train de disparaître, sur cette humanité des marges, hors de l’occident, qui est menacée et risque d’être détruite par ce dernier. Il s’agit de l’un des grands auteurs occidentaux ayant critiqué de manière explicite et féroce la colonisation et son impact sur les populations qui en étaient victimes. Il anticipe donc tous les mouvements de mondialisation qui n’ont fait que se confirmer par la suite au cours du 20e. Mais c’est aussi un écrivain qui est profondément archaïque ; il est préoccupé par des notions qui n’ont plus de valeurs dans l’occident actuel : la fidélité, la promesse, le respect de la parole donnée et la manière dont un individu peut décider de vouloir disparaître parce qu’il n’a pas réussi à tenir sa propre parole. Tous ces thèmes sont devenus importants dans le roman et il y a bien ici résonnance entre les thèmes évoqués dans L’île de la Sentinelle et l’œuvre magnifique de Joseph Conrad.
- Si Conrad illustre chaque partie du roman et si certains de vos thèmes sont communs, on pense également en vous lisant à l’œuvre de Claude Lévi-Strauss – notamment lorsqu’il est question des tribus qui vivent sur les Andamans.
Tristes Tropiques ou de façon plus général le travail de Lévi-Strauss a -t-il exercé une influence sur votre écriture ?
Oui, une influence réelle en effet. J’ai relu Tristes Tropiques à l’occasion de l’écriture de ce roman. Ce qui est magnifique chez Lévi-Strauss, c’est le talent litteraire authentique de ce très grand anthropologue. C’est non seulement un des grands intellectuels du 20e siècle, mais aussi un authentique écrivain. Les pages de Lévi-Strauss consacrées aux Nambikwaras et à son expérience du Brésil sont absolument splendides. Ce qui est très réussi dans l’œuvre de Lévi-Strauss, c’est cette dualité entre récit de soi et œuvre anthropologique. D’une certaine manière cela recoupe la dualité dont il est question dans mon livre puisque le personnage principal, Krish, d’origine indienne, est lui-même anthropologue.
Il y a effectivement une forte influence de Lévi-Strauss dans mon texte, et notamment quand Krish se rend dans la tribu des Jarawas. Dans cette tribu, il réfléchit aux croyances religieuses de ce peuple ; j’ai voulu retrouver dans mon roman cette alternance Lévi-Straussienne entre récit et observations anthropologiques, creuser la réflexion sur ce peuple et sur ses croyances religieuses.
- Les deux amis se rencontrent à l’université Yale et sont rapidement liés par leur appartenance à la fraternité de Saint Andrew. Vous décrivez le monde des fraternités américaines, ses codes et rituels puis quand Krish termine sa thèse le processus de candidature pour obtenir un poste universitaire. Krish, comme vous, est émigré et fait des États-Unis son pays d’adoption. Il semblerait qu’il y ait donc dans votre roman un matériau autobiographique important ?
C ‘est juste. Un écrivain parle bien des choses qu’il connaît bien. Le travail de l’écrivain c’est de reconnaître ce qui dans sa propre expérience autobiographique a une dimension potentiellement romanesque. J’ai également voulu traiter de sujets qui n’avaient pas forcément beaucoup d’existence dans la littérature française actuelle. Les Etats-Unis de mon roman ne sont pas ceux que l’on connaît. Je parle d’une petite ville, New Haven, sur la côte Est, puis du Midwest. Vous savez, lorsque le roman français parle des Etats-Unis, il ne s’empare pas du Midwest. J’ai donc essayé de saisir dans ma propre expérience autobiographique ce qui pouvait avoir un intérêt plus général, et aussi peut-être ce qui était sous représenté dans la production littéraire actuelle française.
- Vous nous parlez des années Trump, du milieu universitaire ; votre personnage, narrateur, est émigré comme vous l’êtes, est-ce que ce regard distancé d’émigré aux Etats-Unis vous a aidé ?
L’île de la Sentinelle est effectivement aussi un roman sur l’exil, sur la difficulté à se faire une place dans un pays qui n’est pas le sien à l’origine. Mais Krish n’est pas n’importe quel exilé car, à ma différence, c’est un exilé venant d’un pays plus pauvre. Il est Indien et appartient à une minorité, dans son propre regard comme dans le regard d’autrui. J’ai voulu explorer cette difficulté inhérente à trouver sa place dans un pays qui n’est pas le sien et qui ne prévoit pas nécessairement une place pour vous lorsque vous n’appartenez pas à la bonne catégorie sociale ou ethnique.
- On sent d’ailleurs dans le livre à maintes reprises que Krish semble souffrir du syndrome de l’imposteur, puisqu’il n’est pas du même niveau social et économique que ses camarades de Yale….
Oui, le personnage vient d’un milieu social très humble. Il commence à faire ses études à Columbia puis il fait sa thèse en anthropologie à l’université de Yale et par la force des choses il se retrouve dans un milieu social et économique qui n’a absolument rien à voir avec celui de ses origines. C’est cette confrontation entre ces deux mondes qui m’a intéressé. L’autre personnage principal du roman, Markus, appartient à la différence de Krish à l’élite américaine dans ce qu’elle a de plus classique. Son père est d’origine suédoise, sa mère est américaine. Elle vient d’une famille très fortunée installée à New York. Le livre raconte aussi ce contact entre deux mondes qui se retrouvent à dialoguer l’un avec l’autre alors que rien ne les y destinait.
- Je vais lire maintenant une citation tirée du Voyage en Orient de Lamartine « Je n’ai presque jamais rencontré un lieu et une chose dont la première vue ne fût pour moi comme un souvenir. Avons-nous vécu deux fois ou mille fois ? (..) Avons-nous dans notre imagination, la puissance de pressentir et de voir avant que nous voyions réellement ? Questions insolubles ! ». Vous semblez avoir parfaitement illustré ces propos dans L’île de la Sentinelle, pouvez-vous nous expliquer en quoi ?
C’est un beau passage que je ne connaissais pas et je comprends pourquoi vous l’avez choisi. Effectivement un des thèmes qui traverse le roman est celui du « déjà-vu », celui d’une intuition, non rationnelle et non démontrable par des preuves. Mais le roman c’est aussi cela : un espace où on peut se permettre d’explorer une pensée qui n’est pas toujours une pensée rationnelle, argumentée comme dans une œuvre universitaire. Dans ce roman, il est question du thème du « déjà-vu » comme expérience de familiarité soudaine, le signe d’une connaissance anticipée de ce qui va nous arriver à l’avenir. Peut-être avons-nous tous une connaissance intuitive de ce qui va arriver à des moments fondamentaux de notre vie, en particulier lorsque cela touche aux ruptures qui vont la traverser. L’île de la Sentinelle explore cette intuition.
- Markus souffre de façon pathologique de « déjà-vus », de ces impressions de souvenirs dans le présent. Est-ce aussi une façon de montrer la complexité entre le passé et le présent ? De montrer tel que Bergson le disait que seul le présent existe, qu’il n’y a pas de passé, ni de futur. Avez-vous souhaité aller dans cette direction ?
Oui, il y a quelque chose de cet ordre. Je l’ai peut-être d’avantage exploré d’une manière intuitive que d’une manière purement rationnelle. Il y a certains passages qui illustrent cette conception du temps comme s’il y avait des couches de temps toutes simultanées les unes avec les autres ; comme s’il n’y avait jamais véritablement de passé, mais juste une simultanéité de tous les évènements. Au moment où les personnages arrivent sur l’île de la Sentinelle, il y a un passage très bref où il est question de la co-présence de plusieurs temporalités : la temporalité d’une catastrophe qui s’est produite dans les années 80, la temporalité d’un passé beaucoup plus ancien qui remonte aux premières interactions entre les occidentaux et le peuple de l’île et enfin celui du moment présent où les personnages arrivent sur l’île. Il y a des thèmes qu’un écrivain injecte d’une manière volontaire, consciente, rationnelle et ceux qui traversent son livre mais qui relèvent davantage de l’inconscient…quelque chose qui est développé presque à l’insu du romancier lui-même. C’est pour cela que très souvent les critiques sont plus intelligents que les romanciers, c’est pour cela que Proust lui-même disait dans Contre Sainte-Beuve : « Chaque jour, j’attache moins de prix à l’intelligence ». D’une certaine manière, l’art du roman est aussi l’exploration de cette autre forme de rationalité, qui n’est pas une rationalité consciente mais qui consiste à mettre ensemble des thèmes qui échappent au romancier lui-même et qu’il appartient à autrui de reconstruire, reconnecter, interpréter. Et pour effectuer ce travail de reconstruction, je suis finalement très mal placé. C’est plutôt aux exégètes, aux lecteurs tout simplement de faire sens de ce qui dans le texte s’inscrit d’une manière spontanée et inconsciente.
- Pour rester sur le « déjà-vu/jamais-vu », vous semblez faire dire ou croire à vos personnages que tout est déjà écrit que toutes nos actions futures sont déjà déterminées ? Est-ce votre point de vue ? N’est-ce pas un peu pessimiste ?
C’est sans doute l’une des plus grandes questions philosophiques : est-ce qu’il y a de la destinée ou est-ce qu’il y a de la liberté ? Dans un de mes premiers romans intitulé Anna Ivanovna, cette question déjà me préoccupait. Est-ce que finalement on a un destin ou bien est-ce qu’il n’y a que du hasard, ce que j’appelais dans le livre, en citant Marc Aurèle, « des atomes qui se heurtent dans le vide ». D’une certaine manière, c’est la grande question qu’on se pose tous. J’y reviens dans L’Ile de la Sentinelle. Ma conviction personnelle, c’est qu’on peut établir une forme de dialectique entre destinée et hasard/liberté. Je pense qu’il y a des évènements auxquels on ne coupera pas, ni vous, ni moi – des évènements qui sont écrits et impossibles à éviter. Tout ce qui existe pour nous, c’est juste du hasard et de la liberté dans les interstices, entre ces grandes ruptures qui vont intervenir dans notre vie. Il y a une présence dans le roman assez subtile mais latente, sous-jacente, du bouddhisme. Dans le bouddhisme, il y a quelque chose qu’on appelle le karma, quelque chose qui prédétermine dans notre existence des moments de souffrance, des moments de catastrophes individuelles qui vont se produire et qui sont la conséquence d’une très ancienne causalité qui ne remonte même pas à notre existence actuelle mais aux existences passées. Étant bouddhiste moi-même, c’est cette conception là que je retiens.
- Autre thème central dans le roman : la filiation ou la transmission – ces réflexions sur la filiation tiennent une place importante dans votre œuvre car elles sont aussi au cœur d’un autre de vos récits : Père et fils. On la voit ici dans la relation entre Markus et Joakim, ainsi qu’avec Krish et son désir de paternité. Quelle est l’importance de la filiation dans votre roman ? Y a -t-il une analogie avec l’île ?
Je suis d’accord avec vous, la filiation est importante dans le livre. On a deux personnages en miroir : Krish et Markus qui ont un rapport distinct à la filiation. Krish est quelqu’un qui a perdu ses parents dans un attentat terroriste – attentat qui s’est réellement produit en Inde en 2008 – c’est un être sans famille. Markus, quant à lui, est un personnage qui a trop de filiation et qui d’une certaine manière est écrasé par le modèle d’un père extraordinairement brillant qui a réussi à créer une véritable fortune ex nihilo dans le monde de l’art. J’ai voulu travailler en miroir entre ce personnage sans famille et ce personnage qui au contraire essaie de s’inventer lui-même en dépit de sa famille et en dehors de l’orbite paternelle qu’il n’arrive pas à fuir puisqu’il finit par travailler pour lui et devenir ce que son père avait souhaité qu’il devienne.
- Je vais lire une citation du roman : « Les Sentinelles tenaient le flambeau, vous comprenez, de tout ce qui est envoûtant mais vous échappe, de tout ce qui laisse entrevoir des merveilles mais ne se réalise jamais. (…) Pour nous tous il fallait qu’ils survivent car ils gardaient, intact et fragile, quelque chose de la beauté du monde et comme la promesse qu’un jour nous fussions pardonnés. »
En lisant ce passage, je ne peux m’empêcher d’y entendre un écho à Marguerite Yourcenar qui fait dire à l’empereur Hadrien dans Les Mémoires d’Hadrien : « Je me sentais responsable de la beauté du monde». Selon vous, sommes-nous responsables de cette beauté et avons-nous le devoir de préserver le mystère de l’île de la Sentinelle ?
La beauté dont Hadrien se sentait responsable, c’était la beauté de son empire, celle de la civilisation romaine. Pour nous, deux millénaires plus tard, les données du problème ont changé, elles se sont même inversées : il ne s’agit plus de défendre la civilisation contre la barbarie, mais de protéger la nature contre l’excès de civilisation. À cet égard, L’île de la Sentinelle est aussi un roman sur cette capacité de destruction qui est inhérente au désir. Lorsque le désir est satisfait, son objet est détruit. On peut avoir très envie d’aller sur l’île de la Sentinelle, de pénétrer ce mystère, mais c’est alors faire disparaître les raisons pour lesquelles on était attiré par cet espace. Le mystère disparaît, on connaît les Sentinelles et on risque de les mettre en danger et de les anéantir. Le roman nous invite à sanctuariser ces derniers espaces qui nous échappent, qu’on ne contrôle pas, sur lesquels on n’a pas de main mise, dont nous ne nous sommes pas rendus « comme maîtres et possesseurs » comme le disait Descartes. Parce qu’on risque alors d’être tout seul avec nous-mêmes, ce qui est vraiment très triste. Les Sentinelles maintiennent quelque chose de l’ordre de la beauté du monde, de la diversité, de l’inconnu, ce que justement nous sommes dans l’occident en train de détruire de manière systématique.
- Question du public : Est-ce qu’on pourrait imaginer une suite à ce roman ?
Hélas non, car le roman se termine sur un épilogue qui est projeté dans un avenir lointain et qui imagine que les Sentinelles auront disparu. Les microbes, les maladies, les hasards auront provoqué la disparition de l’île de la Sentinelle.
À la fin du texte l’île de la Sentinelle est muséifiée, elle devient un espace de remémoration du peuple des Sentinelles et de ceux des Andamans en général. La possibilité d’une suite n’existe donc pas et le roman est véritablement clos.
- Mais s’il n’y a pas de suite, en revanche je crois savoir qu’une traduction est prévue…
Oui, je l’espère. Nous y travaillons actuellement puisque le roman vient de paraître en février. Mon traducteur et ami, Alan Singerman, sera le traducteur en anglais. Rien n’est encore concrétisé mais je ne manquerai pas de vous en faire part le moment venu si jamais le livre est traduit.
- Nous l’espérons. Merci Benjamin pour ce très beau roman et pour cet entretien !