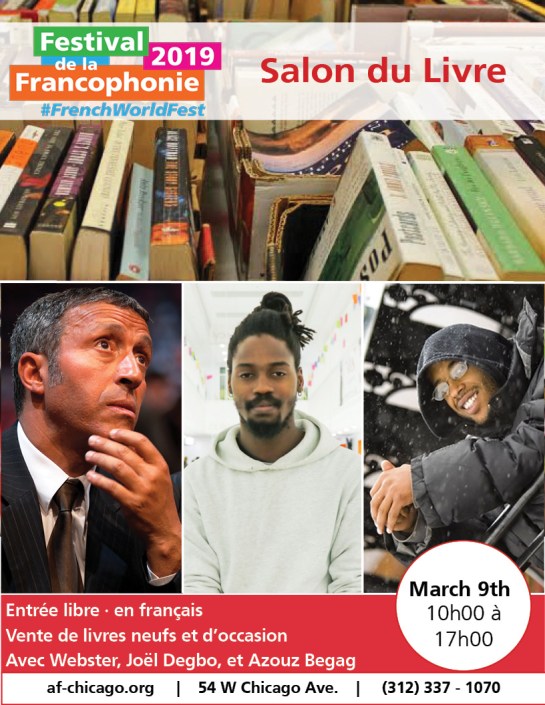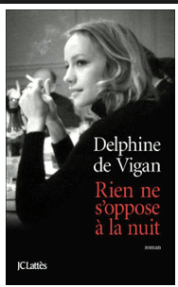Lire, c’est avant tout relire, comme je le dis souvent. Je viens de le faire pour le livre de Bernhard Schlink, paru en 1997 Der Vorleser, traduit en français sous le titre Le liseur par Bernard Lortholary (traducteur émérite connu notamment pour sa traduction du roman de Süskind Le Parfum).
Lire, c’est avant tout relire, comme je le dis souvent. Je viens de le faire pour le livre de Bernhard Schlink, paru en 1997 Der Vorleser, traduit en français sous le titre Le liseur par Bernard Lortholary (traducteur émérite connu notamment pour sa traduction du roman de Süskind Le Parfum).
Le roman m’avait beaucoup plus à sa sortie et bien avant qu’il ne soit traduit dans 32 langues, ainsi que le film sorti en 2009 de Stephen Daldry – chose plus rare.
Je relis Der Vorleser et le sentiment est intact, plus clair cependant comme après toute relecture.
Un homme d’une cinquantaine d’année, raconte l’histoire d’un pan de sa vie, son histoire intime à travers la grande Histoire, celle de la seconde guerre mondiale et de l’holocauste. Il écrit à la fois pour guérir, effacer mais aussi pour faire revivre et se rappeler.
1958, Michael Berg a quinze ans et attrape la jaunisse. Malade et vomissant dans la rue, une femme lui vient en aide et le ramène chez lui. La situation porte peu à une future romance et pourtant c’est le début d’une liaison entre le jeune lycéen et la femme, de vingt ans son aînée. Après sa convalescence il lui rend visite pour la remercier de son geste, elle le séduit bientôt et fait de leurs rencontres un rituel amoureux empreint de lecture à haute voix, de bains et de sexualité « das Ritual des Vorlesens, Duschens, Liebens und Beinanderliegens ». L’image de la femme est auréolée de mystère, on apprend peu d’elle, si ce n’est qu’elle s’appelle Hanna Schmitz et qu’elle est contrôleuse de tramway. Ni franchement belle, ni laide, elle se définit par sa force, son déterminisme et ses colères incompréhensibles qui laissent Michael alias « Jüngchen » pour Hanna dans le désarroi. Les mois passent, les rencontres ponctuent la vie de Michael qui oscille entre sa famille bourgeoise, l’école et les après-midis dans les bras d’Hanna, à lui lire les œuvres qu’il étudie en classe, celles de Lessing, Tolstoï, Schiller ou Eichendorff.
De son amour il tire sa force, prend de l’assurance et s’impose par rapport à ses camarades, encore gauches et peu sûrs d’eux.
Le couple clandestin se retrouve chaque jour en cachette, autour du même rite : lecture, ablutions, étreintes. Les vacances venus ils partent en bicyclette à la campagne, se faisant passer pour mère et fils. L’été bat son plein, leur amour semble à son apogée et soudain Hanna disparaît, sans explication.
Dans la seconde partie du roman, on retrouve Michael, étudiant en droit. Meurtri par la disparition d’Hanna, par son évanescence arbitraire il se montre fermé, voire cynique envers son entourage. Lors d’un séminaire de droit, il assiste au procès de cinq femmes, anciennes gardes de camp de concentration, accusées de crimes. Parmi ces femmes se trouve Hanna, dont on apprend enfin le passé. Née en 1922, elle travaille à Siemens à Berlin puis rejoint de son plein gré les SS en 1943. Elle est garde à Auschwitz avant de passer dans un camp plus petit près de Krakau. Dans ce camp les prisonnières travaillent, mais chaque mois soixante d’entre elles, les plus faibles, sont sélectionnées pour Auschwitz où une mort certaine les attend. La selection est faite par les gardes, ce qui constituera le premier chef d’accusation du procès. Le second, encore plus choquant, est lié à la fuite du camp en 1945, quand une nuit l’église dans laquelle dormaient les prisonnières, prit feu et que les gardes refusèrent d’ouvrir les portes, les condamnant ainsi à mourir brûlées ou asphyxiées. Un rapport est écrit, retrouvé dans les papiers des SS après la guerre. Il sert de base au procès ainsi que la déposition d’une des deux seules survivantes de l’église.
Accusée par les autres gardes d’avoir rédigé le rapport, Hanna s’enlise dans de vagues explications où le devoir d’obéissance aveugle, d’ordre à tout prix, semble avoir supplanté pensée et jugement moral. Elle avance des arguments fallacieux, prend à témoin le juge lui demandant ce qu’il aurait fait à sa place se montrant dans toute la naïveté de sa cruauté encore plus coupable, froide et perverse. On apprend enfin qu’elle protégeait certaines détenues et qu’elle les faisait lire pour elle le soir, avant de les laisser partir ensuite lors d’une prochaine sélection pour Auschwitz. S’agissait-il d’un acte altruiste pour épargner quelque temps de futures victimes condamnées à la mort quoiqu’elle fasse? Ou bien plutôt de déviance et peut-être d’abus sexuel ?
Les semaines de procès passent. Pour trancher les responsabilités liées à l’incendie de l’église le juge propose finalement un examen graphologique de l’écriture des cinq gardes afin de déterminer celle qui a écrit le rapport et donc dirigé le groupe. Prise de panique et voulant à tout prix éviter qu’on lui demande d’écrire, Hanna s’accuse et scelle son sort. Elle est condamnée à perpétuité.
Michael assiste à toutes les séances du procès, et sait qu’Hanna l’a reconnu dans la salle du tribunal. Avec effroi il découvre que d’autres lui servaient de liseurs ou liseuses et réalise enfin le mystère qu’Hanna cherche tant à cacher, celui de son analphabétisme. Hanna ne sait ni lire, ni écrire, a fui Siemens pour cette raison, fui ensuite la petite ville dans laquelle on voulait la promouvoir au rang de conductrice de tramway, a fui enfin vers la prison plutôt que d’avouer son illetrisme.
Dans la troisième et dernière partie du roman, Michael est professeur d’histoire du droit, marié et père d’une fille, il divorce bientôt car aucune femme après Hanna ne semble la bonne « Ich hatte das Gefühl, dass es nich stimmt, dass sie nicht stimmt, dass sie sich falsch anfasst und anfühlt, dass sie falsch riecht und schmeckt. » Les prénoms défilent, sans consistance, chacun associé à un métier pour mieux les définir, faute de mieux. Seul, il reprend ses lectures à haute voix, celles de Schnitzler, Fontane, Mörike ; il s’enregistre et envoie les cassettes sans autre mot à Hanna. Quatre ans plus tard et à raison de colis réguliers, il reçoit une note tracée d’une écriture gauche, le remerciant pour les cassettes. D’autres suivront, concises, commentant brièvement les livres choisis, en réclamant d’autres. Le nouveau rituel, initié cette fois par Michael, dure dix ans ; puis une lettre envoyée par la directrice de la prison lui annonce la sortie prochaine d’Hanna, libérée pour bonne conduite. Michael organise un appartement, lui trouve un travail, et finalement sur les instances de la directrice de la prison lui rend visite quelques jours avant sa sortie. Une vieille femme, alourdie par les années, dont seule la voix a gardé la jeunesse, lui fait face. Le dialogue est maladroit, n’aboutit pas et le jour convenu, Hanna se suicide, ne laissant de nouveau aucune explication pour son acte, juste la demande de remettre l’argent contenu dans une boîte en métal à la jeune prisonnière du camp qui avait survécu à l’incendie de l’église. Michael retrouve cette femme à New York et lui remet l’offrande dont elle ne prend que la boîte comme souvenir, refusant d’accepter l’argent – ce qui à ses yeux, équivaudrait à pardonner à Hanna. L’argent est donc remise à l’association juive contre l’analphabétisme.
C’est avec la lettre de remerciement pour la donation faite au nom d’Hanna Schmitz que Michael va pour la première et dernière fois se recueillir sur la tombe d’Hanna.
Le roman couvre plus de trente ans d’histoire et est bâti en trois parties assez régulières, faites de chapitres courts et de phrases brèves, voire tranchantes « Ich sah Hanna im Gerichtssaal wieder », ou bien « Hanna bekam lebenslänglich » ou enfin « Am nächster Morgen war Hanna tot ». Il tourne autour de l’obsession : l’obsession amoureuse, celle du passé, celle aussi des manques à combler voire à cacher.
Schlink, juriste lui-même, né à un an près comme son personnage Michael Berg, soulève de nombreuses questions sans vraiment proposer de réponse nette. Tout est complexe, à facettes et perçu différemment selon l’angle choisi. Il s’interroge sur le devoir et le travail de mémoire, sur celui plus vaste encore de la culpabilité et de la honte. Où se trouve la vérité ? Le concept est-il pluriel ? Comment délimiter de façon claire et certaine la frontière du bien et du mal? Où s’arrête la responsabilité, la liberté et la dignité de chaque être humain ? Enfin, comment l’horreur peut-elle être ravalée à la banalité ? A cette banalité de l’horreur qu’Anna Arendt souligne dans ses réflexions lors du procès d’Eichmann (Eichmann in Jerusalem): « Das Bunruhigende and der Person Eichmanns war doch gerade, dass er war wie viele (…) erschreckend normal (…) Diese Normalität war viel erschreckender als all die Greuel zusammen »
Ni sympathique, ni totalement antipathique, avant tout banal et médiocre, le personnage d’Hanna nage dans le mystère et le trouble. Elle est souvent glaciale et inaccessible, faite d’une force brute qui angoisse. Tentaculaire, manipulatrice elle semble néanmoins aussi la proie de sa propre névrose, d’une vulnérabilité qui ne trouve de salut que dans l’isolement et la violence. Les livres, l’espace littéraire qu’ils offrent, lui apportent alors l’ouverture au monde. Elle vit au travers du liseur, accède ainsi au langage et à la communication. Car l’échange entre Hanna et Michael se fait par deux médiums, celui des livres lus et des caresses échangées. La littérature est en quelque sorte ce qui scelle leur amour – la passion physique devenant indissociable de l’acte de lecture, en étant l’aboutissement. Des années plus tard, Michael n’arrivera encore à communiquer avec Hanna qu’à travers la lecture « Das Vorlesen war meine Art, zu ihr, mit ihr zu sprechen », Il lui lira des œuvres d’auteurs connus ou bien ses propres écrits.
Les mots lus remplacent ceux qu’on ne peut dire et masquent surtout l’impossibilité de communiquer (Sprachlosigkeit).
Emotionnellement dépendant à l’égard d’Hanna, Michael, se fait violence, accepte toutes les règles qu’elle lui dicte. Et quand une querelle éclate, il se montre prêt à s’accuser de tous les torts plutôt que de supporter l’idée de perdre l’amante, la mère, la tutrice. Hanna est son mentor, celle qui lui ouvre la voie, et permet à l’adolescent mal dans sa peau de changer de chrysalide pour devenir un homme adulte.
En revanche si c’est elle qui l’initie au plaisir sexuel et au sentiment amoureux, ce sera Michael plus tard qui deviendra le tuteur, le guide. Il lui donnera accès au monde et au savoir en lui apprenant à lire par le biais des cassettes enregistrées. Car dans sa cellule, Hanna écoutera chaque cassette et reconstituera avec patience, le livre en main, chaque phrase, chaque mot.
Dans le roman, aucun rôle n’est définitivement arrêté et les rapports de force changent. Ainsi la relation victime-bourreau n’échappe pas à cette notion de possible interchangeabilité et les limites séparant les deux concepts pourtant antithétiques sont parfois difficiles à cerner. Blanc-noir, difficile de trancher.
La fin est abrupte, Hanna se suicide et laisse liseur et lecteur dans l’interrogation du départ. Doit-on y voir une prise de conscience tardive face à un passé trop lourd, les remords acquis après la lecture de livres sur l’holocauste, une peur de l’avenir, un constat d’échec ou une simple fatigue de la vie?
Der Vorleser est un roman, court et facile à lire. Il soulève cependant des questions complexes sur l’appréhension de l’histoire ainsi que la psychologie et les relations humaines. Quant au film, tiré du livre, il sait montrer avec justesse toute l’ambiguïté sur laquelle repose le roman.