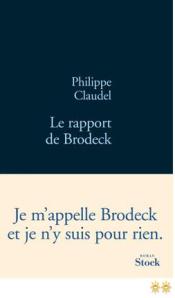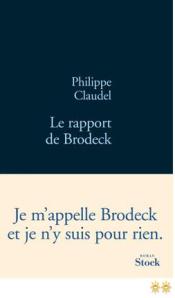 Le Rapport de Brodeck
Le Rapport de Brodeckse présente comme une fable à l’atmosphère kafkaïenne. Le lecteur est plongé dans un village d’outre-Rhin, de quelques quatre cent âmes, sans emplacement déterminé et sans nom. De mystérieux et terribles événements se sont passés dans le passé et Brodeck, narrateur et héro principal, raconte. On mène l’enquête au rythme de la lecture et apprend vite à discerner les personnages par leur rôle ou statut social. Il y a le maire, l’instituteur, l’aubergiste, le voisin, le curé, et une auberge nommée « das Schloss » où s’est déroulé l’Ereigniës, ce drame à l’origine du récit.Brodeck, plus instruit que ses concitoyens, occupe au village des fonctions proches de celles d’un garde champêtre, il écrit les rapports sur la nature, « la flore et la faune ». Au regard des autres, il est celui qui a le pouvoir des mots « tu sais écrire, tu sais les mots, et comment on les utilise, et comment aussi ils peuvent dire les choses ». Pour purger le mal de la conscience collective, l’absoudre en quelque sorte, on l’enjoint sous la menace de prendre la plume et de raconter: « Tu vas raconter l’histoire, tu seras le scribe » « Il faudra vraiment tout dire afin que celui qui lira le Rapport comprenne et pardonne ».
C’est à l’écriture que revient le rôle d’exorciste, elle seule peut mener vers le salut ou le pardon. Car la mémoire et la conscience sont les attributs qui différencient au mieux l’homme de l’animal, l’individu des porcs d’Orschwir, le maire du village, ces « fauves sans cœur et sans esprit », pour lesquels seul le ventre compte, et qui « ne songent qu’à une chose, tout le temps, c’est de pouvoir le remplir ».
Brodeck rédige son rapport, ou plus précisément ses deux rapports ; celui que tout le monde veut lire, pour ensuite mieux détruire, ainsi qu’un autre en parallèle qui fera l’objet de ce roman et qui dira la honte, la vérité cachée.
Un jour « toute en douceur et teintes blondes » car Brodeck se souvient de la date, le 13 mai, un étranger arrive au village. Son costume est étrange, son allure bouffonne, et il est flanqué d’un cheval qu’il appelle Monsieur Socrate ainsi que d’un âne, Mademoiselle Julie.
Depuis que la guerre a pris fin, un an auparavant (entendons la seconde guerre mondiale), c’est le premier visiteur à venir au village. Personne ne sait d’où il vient, qui il est et pourquoi soudain il est là. Personnage énigmatique on l’appelle vite l’Anderer (l’autre) ou on le surnomme dans le dialecte local tantôt «Vollaugä » (yeux pleins), « De Murmelnër » (Le murmurant), « Mondlich » (lunaire), « Gekamdörhin » (celui qui est venu de là-bas), ou bien encore « de Gewisshor » (le savant). Personne ne l’aime, tout le monde le craint sauf Brodeck qui d’emblée se retrouve en lui « Parfois même, je dois l’avouer, j’avais l’impression que lui, c’était un peu moi. ».
Erudit, poli, toujours gentil, l’Anderer écoute et sourit plus qu’il ne parle. Il rappelle le Saint ou le prophète, et son destin semble prédéterminé « Parfois en le regardant, j’avais songé à quelque figure de saint. C’est très curieux la sainteté. Lorsqu’on la rencontre, on la prend souvent pour autre chose, pour tout autre chose, de l’indifférence, de la moquerie, de la conspiration, de la froideur ou de l’insolence, du mépris peut-être. On se trompe, et alors on s’emporte. On commet le pire. C’est sans doute pour cela que les saints finissent toujours en martyrs ». Ou peut-être s’agit-il d’un messie, venu pour racheter le monde en perdition, « un dernier envoyé de Dieu avant qu’il ne ferme boutique et ne jette les clés » comme le souligne amèrement le curé.
L’homme d’église, Peiper, a perdu la foi à force d’avoir entendu tout ce « chargement putride » de confessions. Il boit pour oublier, pour ne plus penser. Tous d’ailleurs au village ont recours à l’alcool pour faire taire leur peur ou leur conscience.
L’Anderer arrive dans ce village coupé du monde, mort à toute croyance, et révèle à chacun ce qui se cache en lui. Il écoute, récolte les confessions, celle de Brodeck notamment, fait des croquis, esquisse les portraits de tous les habitants et finalement organise une réception où il montre ses œuvres. Miroirs de l’âme, soudain mise a nue, ces portraits, où chaque citoyen se reconnaît dans sa vraie nature, signeront son arrêt de mort et le village entier ourdira alors une macabre mise à mort.
Le style du roman est riche en descriptions et la structure est captivante, faite de permanents retours en arrière, d’histoires dans l’histoire. Il y a le temps de la narration, soit celui d’après l’écriture du rapport, mais aussi les coulées dans la mémoire qui font revivre à Brodeck et découvrir au lecteur le fameux Ereigniës (scène de mise à mort), l’arrivée de l’étranger, la vie au village, la guerre, ses études à la capitale, sa jeune enfance, ses amours avec Emilia, les camps et d’autres secrets bien gardés au fond de l’inconscient collectif.
En remontant le temps, des lambeaux de souvenirs, lui reviennent. Ceux de sa petite enfance lorsqu’orphelin, âgé seulement de quatre ou cinq ans, la vieille Fédorine, déjà « tavelée comme une nèfle oubliée trois saisons dans le cellier », le recueille sur son chemin. Ensemble, ils traversent des montagnes, des pays et des langues, sur une charrette de fortune avant d’arriver au village qui leur donne une cabane. Ceux ensuite du jeune homme parti étudier à la ville grâce aux cotisations des villageois. On assiste à la montée de la violence et de l’antisémitisme et à la fuite de Brodeck vers le village un matin en compagnie d’Emilia, la jeune fille rencontrée à la ville, qu’il prend pour femme. La haine déborde la ville et rattrape le village bientôt sommé de désigner ses traites. Dénoncé comme étranger « Fremdër », sacrifié pour sauver les autres, Brodeck est déporté dans un camp de concentration.
Six jours de voyage marquent sa lente descente en enfer. Six jours traumatiques ou les plus faibles meurent, ou le choix aussi s’impose entre les futurs morts et futurs survivants, car par delà les aptitudes physiques de survie il y aura celles de la conscience et de l’acceptation ou non de l’humiliation. Dans le camp, les nazis appliquent minutieusement leur politique d’humiliation et de deshumanisation en réduisant chaque homme à un animal. Qui veut survivre doit oublier qu’il est un homme, et être prêt à se plier à tous les déshonneurs.
Brodeck n’a qu’une seule pensée, celle de survivre, pour rentrer et retrouver sa femme à laquelle il a fait la promesse de revenir. Il accepte donc tout, de n’être rien, de ne plus avoir ni langage ni dignité. Il devient tout d’abord le « scheizeman » (l’homme merde), chargé de vider à mains nues les latrines du camp, puis le « chien Brodeck » qui rampe, marche à quatre pattes, aboie, lape, se laisse mener en laisse, et dort dans une niche.
L’évocation des camps et l’idée de l’individu ravalé à une masse informe « des ombres pareilles les unes aux autres » ne sont pas sans rappeler le témoignage de Primo Levi sur l’holocauste et notamment Se questo è un uomo (Si c’est un homme), l’œuvre également d’un autre auteur déporté dans les camps, Jorge Semprun. Semprun décrit dans l’expérience concentrationnaire l’au-delà ou plus exactement la traversée de la mort (je renvoie à un autre billet sur cet auteur dans ce blog, Jorge Semprun « Adieu vive clarté… »).
A ce propos enfin, il est intéressant de noter que Philippe Claudel vient d’être élu il y a peu par l’Académie Goncourt au couvert de Semprun, mort le 7 juin 2011. Le choix n’est pas neutre.
« Depuis le camp, je sais qu’il y a davantage de loups que d’agneaux » dit Brodeck. L’expérience des autres, certes, de lui-même aussi, pris dans l’engrenage de la peur et du besoin. Car la question morale dans le roman est toujours présente et personne n’y échappe. Comment réagit-on dans une situation extrême, acculé à ses limites, face au mal ? Et le pardon est-il possible ?
Plusieurs souvenirs harcèlent Brodeck. Certains traduisent bien l’ambigüité du mal, comme l’épisode du wagon et de l’eau dérobée à la jeune mère et son nourrisson, celui aussi de cette jeune aryenne qui berçant avec amour son enfant dans ses bras regarde chaque matin au camp avec jouissance la pendaison de la victime du jour. L’amour et l’innocence se mêlent à la haine et la perversité et si les loups torturent Emilia, sa femme, la rendent folle à jamais ; c’est néanmoins la beauté qui au final l’emporte dans le regard de Poupchette, l’enfant « née de l’horreur».
Brodeck finit par quitter le village, avec sa femme, sa fille et la fidèle Fédorine. Le lecteur, lui, quitte le roman avec l’impression d’avoir traversé une œuvre grave, terriblement humaine, et toujours profondément actuelle.