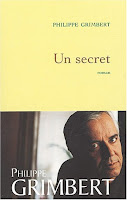Il y plusieurs façons de lire La vie mode d’emploi, une façon linéaire, traditionnelle, allant du premier chapitre au dernier ou bien une lecture axée sur les histoires et pouvant donc sauter allégrement d’un chapitre à l’autre pour retrouver la famille/l’histoire en question. Les deux semblent faire sens et répondent plus au goût de chacun qu’à une nécessité intrinsèque du roman. Rares sont cependant les livres qui ne perdent rien à une lecture éparse ou non linéaire. Nous sommes donc bien ici dans le registre du manuel ou du guide pratique plus que dans celui du roman traditionnel. Perec engage son lecteur à suivre les pistes ou des indications cachées dans son roman.
Suivons tout d’abord la méthode linéaire et voyons quelques chapitres, la façon dont ils s’enchaînent et surtout le nombre de récurrences qu’ils présentent.
Chapitre IV : Il se déroule dans l’appartement des Marquiseaux
Le roman de Perec a été qualifié par un critique littéraire de « Musée Beaubourg du roman ». Ce commentaire semble s’appliquer à merveille à ce chapitre qui est purement descriptif et où aucun personnage n’apparaît. L’auteur nous fait découvrir dans le salon quatre tableaux et nous conte l’histoire qui motive la réalisation du quatrième tableau.
L’auteur reprend quasiment mot pour mot dans le troisième tableau la définition donnée par Rabelais sur la tarande. Perec joue néanmoins avec le lecteur, ne mentionnant pas Rabelais comme l’auteur de cette définition mais Gélon le Sarmate qui fut à l’origine de la première description.
Il y a trois récurrences ou chapitres faisant suite à cette histoire dans le roman. Les chapitres deux et trois présentent alors la famille Marquiseaux composée du jeune couple, Caroline et Philippe, ils sont vus dans la salle de bain lors d’une scène érotique (seule dans le roman) et des parents de Caroline, les Echard. Enfin Perec digresse sur la carrière de Philippe Marquiseaux, ceci lui permettant de conter d’autres histoires, notamment celle du transsexuel « Hortense » alias Sam Horton (technique permanente de l’histoire dans l’histoire).
Chapitre V : Il se déroule dans la salle de bains des Foulerot
On rappelle ici l’histoire centrale – inattendue dans la description du chapitre V, très court (changement de temps verbal et de point de vue).
Un des défis du livre qui peut porter à confusion et même parfois irriter le lecteur tient justement à ce changement permanent de point de vue. La position du narrateur, celui qui parle, qui raconte, change au cours des chapitres.
Note sur la narratologie
On parle en narratologie de focalisation (selon G. Genette). On peut dégager trois grands types de focalisation :
• focalisation zéro : le narrateur a le point de vue de Dieu sur ses personnages, il est omniscient (vision au dessus). Le narrateur n’arrive pas à s’effacer. Il connaît les motivations profondes de ses personnages, souvent avant même qu’ils ne les connaissent eux-mêmes (ex. Balzac, Zola).
• focalisation interne : le narrateur ne dit que ce que sait et voit le personnage (style indirect libre est un des moyens de rendre sensible la vision du personnage ou monologue intérieur – utilisée notamment dans le Nouveau Roman, mouvement littéraire des années 50 regroupant des auteurs comme Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet ou Claude Simon).
• Focalisation externe : le narrateur s’en tient à ce qu’il peut observer du dehors de la conduite de ses personnages. Il en sait moins que ses personnages et se contente donc de les observer, de les décrire, émettant tout au plus des hypothèses sur leurs comportements (ex. romans d’Hemingway).
Il est également intéressant de se pencher sur la temporalité dans l’œuvre. Perec aime alterner avec les temps grammaticaux et jouer sur leur nature – même s’il privilégie clairement l’emploi du présent.
Note sur la temporalité
• Le présent a une valeur ponctuelle (sorte d’arrêt sur image ou instantané figé). Il peut aussi montrer une vérité générale. Il évoque aussi parfois une action passée (présent historique ou de narration / les événements sont vus comme en direct).
• L’imparfait relate des faits passés vus sous l’angle de la durée
• Le passé simple exprime un passé révolu et défini. Il fait progresser le récit. (Évènement de premier plan). C’est le temps littéraire par excellence.
• Passé composé a un rôle similaire au comme passé simple mais il est utilisé surtout à l’oral
Mais le chapitre raconte ici l’histoire banale de la vie quotidienne, celle d’une jeune fille qui va se laver les cheveux.
Il y a trois récurrences dans le roman.
Chapitre VI : il s’intitule Chambres de bonne 1,
Ce chapitre pourrait être intitulé Beaumont 2, puisqu’il conte l’histoire de Béatrice et Anne Breidel, petites-filles de Madame de Beaumont. Perec l’a d’ailleurs bien vu ainsi puisque le chapitre Beaumont 2 n’existe pas, nous passons de Beaumont 1 à Beaumont 3.
Les onze chapitres de chambres de bonne fonctionnent différemment des autres chapitres consacrés aux appartements. Ils relatent une histoire spécifique, voire unique ou bien s’insèrent dans l’histoire des autres chapitres.
L’intrigue liée au meurtre d’Elizabeth de Beaumont/Breidel (fille unique du couple Fernand de Beaumont et Véra Orlova alias Madame de B.) sera ensuite racontée un peu plus loin dans le roman, chapitre XXXI (véritable histoire policière – roman dans le roman).
Chapitre VII : Chambres de bonne 2, Morellet (suite apparemment logique du chapitre précèdent)
L’histoire de Morellet est importante puisqu’elle permet telle une pièce dans le puzzle d’avancer dans la reconstitution de l’histoire centrale. Morellet, préparateur de chimie a l’école polytechnique, trouve un procédé permettant de ressouder les puzzles de Bartlebooth et par la même de retrouver l’aquarelle d’origine – aquarelle qui sera ensuite recouverte d’une substance effaçant toute couleur et ne laissant qu’une feuille blanche.
Inventeur plein d’idées mais non chanceux il finit dans un asile d’aliénés à la plus grande joie de ses voisins les Plassaert qui peuvent ainsi agrandir leur appartement en récupérant une pièce supplémentaire.
Notons ici qu’il n’y a pas de récurrence spécifique liée à Morellet.
Chapitre VIII : ou Winckler, 1
Il raconte l’histoire de Winckler, personnage clef puisqu’il participe du projet de Bartlebooth et de l’histoire centrale. Artisan génial qui habitera l’immeuble une quarantaine d’années. Il est a la fois faiseur de puzzles, de bagues, de « miroirs de sorcières » (miroirs insérés dans « des moulures de bois inlassablement travaillées » jusqu’à devenir de véritables « dentelles de bois »), de jouets pour enfants, mais aussi l’ami du peintre Valène depuis 1932. C’est un être a part, en marge de la société et qui de plus en plus esseulé et finira par ne plus s’habiller et sortir de chez lui.
Il y a trois récurrences dans le roman.
Chapitre IX : Chambres de bonne, 3
C’est une présentation des deux domestiques du peintre Hutting, Joseph Nieto et Ethel Rogers, deux personnages qui apparemment ont peu de choses en commun, des nationalités différentes (Paraguayen et hollandaise) et des âges différents (homme de quarante ans et jeune fille de vingt-six). Aucune indication n’est donnée quant à la relation qui les unit. La seule allusion à une possible intimité est le lit « grand lit de style Empire ». Sont-ils un couple ou ont-ils été simplement assignés dans cette chambre par leur patron ? Perec nous laisse maîtres d’interpréter. Néanmoins une note de l’auteur pourrait laisser pencher pour la seconde option, celui-ci précisant que « Le peintre a prêté ses domestiques » aux Altamont (comme on prête un vulgaire objet).
Par ailleurs la description de ce chapitre rappelle par la précision et la fixité de l’image (objets figés) une peinture, plus exactement une nature morte « Entre le lit et la porte, il y a une petite commode en bois fruitier sur laquelle est posée une bouteille de Whisky Black and White, reconnaissable à ses deux chiens, et une assiette contenant un assortiment de biscuits salés »).
On remarque enfin la construction atypique du chapitre, celui-ci se terminant sur une liste d’ouvrages que le lecteur peut –si bon lui semble- rechercher, compulser (les titres sont à première vue imaginaires).
Enfin après avoir suivi une méthode de lecture linéaire, essayons maintenant une autre clef d’entrée dans le roman, celle de l’histoire, en tant que piste de lecture.
Voici pour les histoires proposées :
– Histoire de l’aviateur argentin
– Histoire du hamster privé de son jeu favori
– Histoire des quatre jeunes gens bloqués dans l’ascenseur
– Histoire du peintre qui peignit l’immeuble
– Histoire du bijoutier qui fut assassiné trois fois
En fait d’aviateur argentin, il s’agit surtout dans le récit de la vie du cuisinier Henri Fresnel, jeune homme attiré par le théâtre et qui par amour de celui-ci finit par délaisser femme et enfant pour se lancer dans une vie d’errance et de vagabondage, jouant pour des années dans une mini troupe d’amateurs et se produisant de villes en villes. « Après onze années d’errance » il devient finalement le cuisinier d’une riche et vieille Américaine, Grace Twinker alias Twinkie. A la mort de sa patronne et à l’instar des autres serviteurs, Henri hérite d’une coquette somme d’argent lui permettant d’ouvrir un restaurant, et de se dédier à d’autres activités telles que la production d’émissions. A sa retraite, il rend visite à sa femme qui le reçoit, l’écoute avant de le jeter à la porte. La femme d’Henri finit sa vie tristement auprès de son fils et de sa méchante bru.
L’aviateur argentin n’est évoqué qu’en rapport avec la richissime américaine. « Fou d’amour pour elle », il se suicide en se jetant « de son biplan après une succession de onze feuilles mortes et la plus impressionnante remontée en chandelle jamais vue ».
De façon surprenante – dans le sens où le lecteur ne s’y attend pas – le chapitre se clôt sur l’évocation d’un homme jeune (nouveau locataire) lors d’une scène autoérotique.
(LV Chambre de bonne 10)
Olivia Rorschash, prête à partir en voyage, prend soin de laisser une liste d’instructions à suivre pendant son absence « Changer tous les deux jours l’eau des fleurs » elle mentionne alors l’histoire cocasse et assez saugrenue du hamster Polinius pour lequel il faut « acheter de l’Etam étuvé et ne pas oublier de l’amener une fois par semaine chez (un certain) Monsieur Lefèvre pour sa leçon de dominos » .On apprend ensuite – avec force détails- l’histoire de Polonius « 43e descendant d’un couple de hamsters apprivoisés par Remi Rorschash (mari d’Olivia) ».
Il est assez clair à la lecture que tout le chapitre tourne sur la note sur le hamster en bas de page, véritable héros de ces trois pages.
(LXXXI, Rorschash 4)
Le récit suivant nous replace quant à lui en 1925 (technique de retour en arrière qui permet à l’auteur de couvrir cent ans d’histoire), lorsque dans la nuit du 14 et 15 juillet l’ascenseur se bloque coinçant quatre personnes dans l’ascenseur : Flora Champigny qui deviendra ensuite Madame Albin, Raymond Albin (alors seulement son fiancé), monsieur Jérôme et Serge Valène. Tous sont rentrés un peu joyeux du feu d’artifice et se retrouvent pendant plus de sept heures enfermés dans l’ascenseur, cherchant à tuer le temps en jouant aux cartes, en mangeant, fumant ou bien encore vociférant au point de faire sortir de leurs appartements les habitants de deux étages. Cette scène, assez classique dans les comédies, semble déjà vue (référence cinématographique : L’ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle).
Enfin le calvaire des quatre malheureux prend fin quand Emile Gratiolet fait fonctionner manuellement le dispositif de l’ascenseur.
(XXXVI Machinerie de l’ascenseur 1)
Le peintre Valène se souvient de tous les locataires de l’immeuble (XVII, Dans l’escalier 2). On passe brièvement en revue la vie de celui-ci, en commençant par son installation rue Crubellier alors qu’il n’avait que dix neuf ans. Le thème choisi est l’escalier, motif le plus souvent campé dans le roman puisque le lieu est évoqué douze fois. La réflexion entamée dans le premier chapitre sur le rôle et la fonction de l’escalier continue ici et le passage devient presque poétique à la fin du chapitre : « Les escaliers pour lui, c’était, à chaque étage, un souvenir, une émotion, quelque chose de suranné et d’impalpable, quelque chose qui palpitait quelque part, à la flamme vacillante de sa mémoire : un geste, un parfum, un bruit, un miroitement, etc.. ». Les comparaisons défilent ensuite et la phrase continue sur une douzaine de lignes.
(XVII, Dans l’escalier 2)
Enfin l’histoire rocambolesque du bijoutier qui fut assassiné trois fois n’est pas sans rappeler celle de la mort d’Elizabeth de Beaumont. Nous sommes en plein roman policier, le lecteur devient enquêteur et reconstitue au fur et à mesure de la lecture les morceaux du puzzle. L’histoire elle-même est enchâssée dans une autre puisqu’elle reprend celle du diamantaire Oswald Zeitgeber, dont la mort pour le moins étrange se trouve illustrée dans le tableau peint par le grand-père de Geneviève Foulerot. De nouveau, Perec s’amuse à compliquer le récit, usant en permanence de la technique de mise en abyme.
(L Foulerot, 3)
Ces deux exercices de lecture montrent donc clairement la « terrible » liberté du lecteur de Perec, confronté à un roman, non traditionnel dans sa forme et son contenu, souvent difficile à suivre, et qui comprend un nombre incalculable de possibles, de digressions plus ou moins travaillées, de pistes volontiers labyrinthiques.
A chacun donc de choisir la piste qui lui convient le mieux….