
Droite, la tige du grenadier semble flotter sur l’eau du bol en céramique, ses feuilles d’un vert foncé sont serrées les unes aux autres ; des boutons sont encore fermés, des fleurs orange vif ouvertes en pétales épais et comme froissés. Il y a quelques minutes, le bouquet d’inspiration japonaise, n’était qu’une simple branche au jardin, celui qui court en de multiples terrasses sous la tonnelle au toit de passiflores. Un morceau de terre surplombe l’autre, chacun est arrêté par un muret de soutènement en pierre sèche et d’un petit escalier à même la muraille que l’on descend attentifs à ne pas glisser. Une journée de juin, au cœur de l’Ardèche, les cigales viennent de se mettre à chanter, signe que l’été est là. La nature est assoupie par la chaleur, mais le ciel soudain assombri gronde sous l’orage. Au soleil répond bientôt la pluie, drue, violente ; puis le ciel se fend d’un grand sourire multicolore qui encercle la vallée en contrebas. La brise fait remonter des odeurs de terre, de châtaigniers et d’herbes humides.

Cinq ans déjà se sont écoulés depuis mon dernier passage, une période trop longue assurément mais je constate, ravie, que rien n’a vraiment changé. Certes, le jardin est encore plus fourni et beau qu’il n’était alors ; quelques améliorations techniques facilitent le quotidien mais le reste est à l’image de ce que j’avais gardé en mémoire. Ce qui surtout n’a pas pris une ride, c’est l’amitié partagée, la conversation qui se poursuit de Vienne à Toulouse, de Paris à Chicago, jusqu’ici. Des pins et arbustes cachent la maison taillée en pierre de grès. Massive et prête à résister aux orages de montagne, elle donne pourtant une impression de légèreté quand d’en bas on l’aperçoit accrochée à flanc de coteau ; petite tâche brunâtre, dans un océan de verdure où se distingue le bleu des volets en bois. Il faut descendre plusieurs volées de marches disjointes pour en trouver l’entrée. L’intérieur se compose d’espaces en voûte comme dans les caves de la région mais aussi de grandes baies vitrées donnant sur plusieurs terrasses qui surplombent un paysage époustouflant. Campés sur l’une d’elles, on admire les potagers, les champs d’oliviers, de blé, les forêts et vignes au loin, puis enfin les montagnes à l’horizon.
La maison, son jardin, et tous ses recoins (ils sont nombreux) accueillent chaque été les amis venus d’un peu partout dans le monde. Les langues et cultures se croisent, les activités et ateliers s’épanouissent : jardinage, lecture, yoga, cuisine, méditation, travail sur bois, peinture – rien d’exhaustif.
Ici, dormir redevient simple, manger est une fête, piocher dans la bibliothèque une évidence et converser un verre ou une tisane à la main la fin naturelle de toute soirée.
Lors de chaque visite, il y a aussi quelques délicieux incontournables : la descente au village où l’école et la mairie jouxtent l’église, le passage à la chèvrerie, chez le boulanger-pâtissier local qui œuvre de chez lui et vend essentiellement sur commandes préalables, ou encore les balades et baignades dans les forêts et sources attenantes aux noms de contes de fée, la rencontre enfin et surtout des deux frères bénédictins de la Demeure Notre Père, située à quelques kilomètres de là.

On y accède par une voie escarpée et pentue qui débouche sur la chapelle où les frères officient plusieurs fois par jour ; il y a les Laudes du matin, l’Eucharistie du midi et les Vêpres du soir. On arrive ensuite à la Demeure, datant du 16e siècle et encore tout imprégnée des siècles passés. La lourde porte en bois franchie, on pénètre dans une courette intérieure qui dessert à droite un large four à pain ainsi que l’enclos à moutons ; à gauche, le « magasin » où s’empilent les bocaux et produits du jardin qui sont ensuite vendus aux passants. Au bout de la courette vient la partie habitable, sur deux étages avec une pièce de vie commune aménagée humblement d’une table en bois patinée par le temps, de quelques chaises en paille, d’une horloge qui scande les heures et d’un âtre noirci par les ans. Une petite statue de vierge trône sur la commode. La bâtisse en pierre n’aime pas beaucoup les ouvertures et l’intérieur est aussi frais que sombre. Au fond, un couloir débouche sur le jardin aux dizaines de terrasses couvertes d’arbres fruitiers, de légumes et de fleurs colorés. Tout attire le regard et fascine mais c’est l’image de la tonnelle de kiwis que j’emporte éblouie.
Les deux frères vivent depuis près de cinquante ans une vie monastique au rythme des prières, du travail agricole bercé par les saisons et des visites de pèlerins de passage. Il font leur pain une fois par semaine, cultivent les légumes et fruits qu’ils consomment, élèvent des moutons dont ils prélèvent la laine et la viande, font du miel qu’ils vendent avec des conserves et confitures de châtaignes. Le petit apport financier vient augmenter leurs maigres retraites et permet de pourvoir aux frais de maintenance de la ferme, de compléter aussi leurs besoins alimentaires et domestiques.
Qui frappe à la Demeure Notre Père est reçu avec un large sourire, des yeux brillants de bienveillance et avec pleins d’anecdotes sur la vie à la ferme, sur les animaux, les récoltes. On apprend ainsi qu’un loup sévit depuis peu dans la région et a tué deux de leurs agneaux, que les lézards du jardin peuvent être aussi gros que des alligators, qu’ils sont tachetés bleus et verts, inoffensifs mais n’ont peur de rien, que les rats des champs volent sans vergogne l’huile d’olive ou le vin encore en tonneaux en trempant leurs queues dans le liquide puis en le léchant, tout simplement… Serions-nous dans une fable de La Fontaine, un conte de Perrault ?
Subjuguées, nous décidons de rester pour les Vêpres dans la chapelle, une messe faite essentiellement de chants accompagnés par la cithare que joue l’un des frères. Deux bancs sont accolés au mur, l’autel fait face à la porte. L’heure est à la communion, à la méditation et deux retraitants qui partagent pour quelques semaines la vie des frères s’ajoutent à notre petit groupe.
Un peu plus tard, nous remontons le chemin, silencieuses, émues surtout par ce moment hors du temps, si spécial et si beau, alourdies aussi par plusieurs courgettes et salades dont les frères nous ont fait don et que nous dégusterons le soir même en pensant à eux, à leur joie, leur foi et leur bonté qui agissent comme un baume sur tous ceux qui passent là-bas.
Si je voulais être exhaustive sur ce court séjour en Ardèche, il me faudrait raconter également les discussions sur Cohen, Perec et la Grèce autour d’une grande marmite à confiture, à tourner à la spatule en bois une mousse d’abricots avec le voisin et ami du lieu qui aura la gentillesse de me ramener à la fin du périple vers le premier mode de transport accessible, soit dix kilomètres plus loin, mais aussi les discussions sur les livres lus et à lire, sur les voyages à venir, en concoctant quelques recettes méditerranéennes qui épousent la récolte du matin,….quelques jours en Ardèche et un profond sentiment de gratitude ainsi qu’une profusion d’impressions, de flagrances que j’emporte avec moi sur la route.










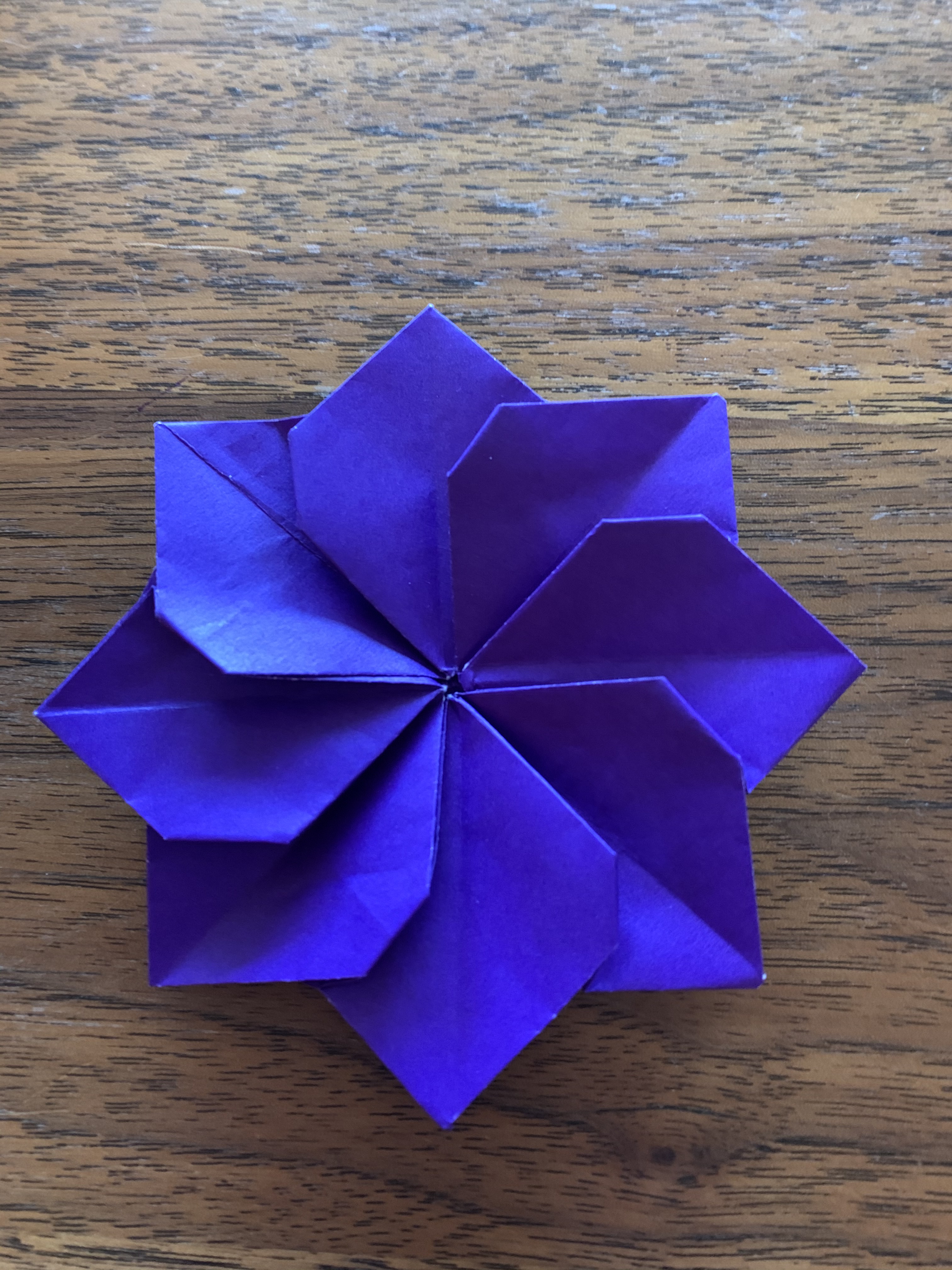






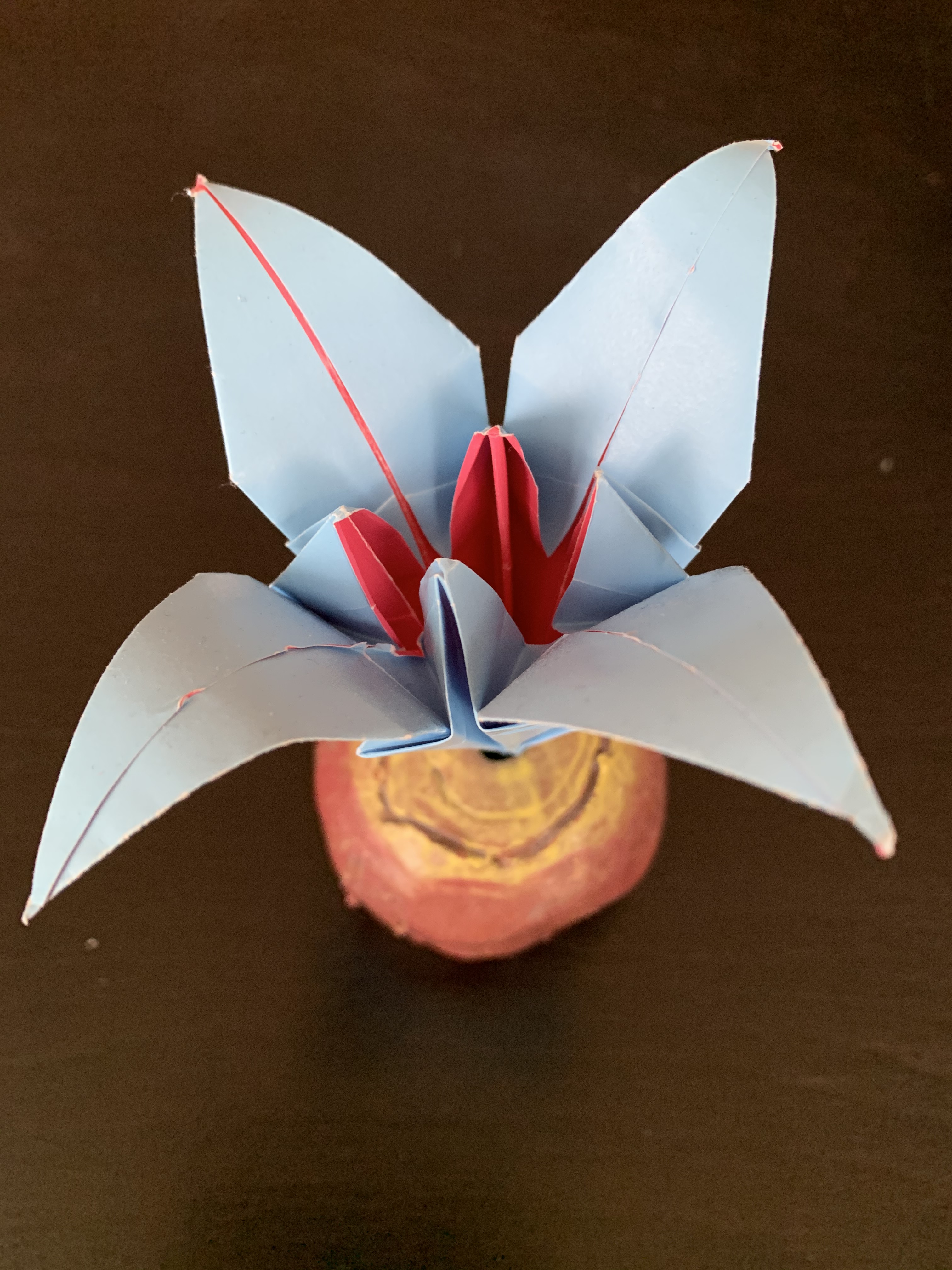





 Paris, un début d’après-midi de décembre, Arno Stern me reçoit rue Falguière dans son atelier. Nous passons deux heures à converser dans le « closlieu », l’espace qu’il a créé pour « le jeu de peindre » et pour ce qu’il a nommé « la formulation ».
Paris, un début d’après-midi de décembre, Arno Stern me reçoit rue Falguière dans son atelier. Nous passons deux heures à converser dans le « closlieu », l’espace qu’il a créé pour « le jeu de peindre » et pour ce qu’il a nommé « la formulation ».

 *
*




