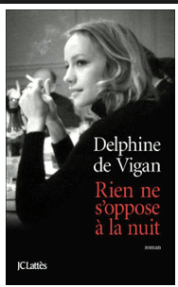Die Wand, traduit par Le mur invisible en français, est le titre du roman de Marlen Haushofer, née en Haute Autriche et morte en 1970 à l’âge de cinquante ans à Vienne. Deux mots, laconiques qui rappellent ceux des romans de Kafka.
Die Wand, traduit par Le mur invisible en français, est le titre du roman de Marlen Haushofer, née en Haute Autriche et morte en 1970 à l’âge de cinquante ans à Vienne. Deux mots, laconiques qui rappellent ceux des romans de Kafka.
Une femme, sans nom, commence la rédaction de son journal, ce qu’elle appelle de façon plus clinique et moins personnelle son « rapport » (Bericht). La date bien que précisée reste vague, noyée dans un temps informe. Les raisons de l’écriture sont données d’emblée. Elle n’écrit pas par désir ou plaisir mais par nécessité, pour ne pas sombrer dans la folie.
Deux ans et demi plus tôt, un couple d’amis plus âgés l’invite à passer quelques jours dans un chalet de montagne, en Haute Autriche. La nature est souriante et les paysages bucoliques promettent un peu de repos au grand air. A peine arrivée le couple part à pied au village, laissant derrière eux leur chien, Luchs. La soirée se passe, puis la nuit et le couple ne rentre pas. La femme et le chien suivent les traces du couple et s’acheminent vers le village. Bientôt ils se heurtent tous deux à une surface transparente, un mur, froid et dur qui empêche toute avancée.
Perplexes, effrayés, ils rebroussent chemin vers le chalet. Les heures passent, puis les jours et rien ne bouge ; le mur reste là, empêchant toute échappée, les gardant prisonniers d’un morceau de montagne, d’un bout de nature.
Stupéfaction, accablement et angoisse oscillent avec l’espoir de se réveiller à tout moment de ce cauchemar, celui d’être sauvée. Mais les jours filent et tout paraît pétrifié derrière le mur, hommes et animaux aperçus plus loin, ressemblent à des poupées de cire, figées à jamais dans l’espace et le temps. Le paysage est le même, la végétation intacte mais toute vie semble s’être retirée au-delà du mur, de cette chose invisible et palpable.
Arpentant son nouveau territoire, la femme tombe nez à nez avec une vache perdue et la ramène au chalet. Un veau, dans ses limbes, naîtra quelques mois plus tard. Une chatte également rescapée rejoint le groupe de survivants. Elle aura une couvée de chatons, puis deux, puis trois.
La vie derrière le mur s’organise. Car il faut pourvoir à la survie de tous. Les animaux deviennent les confidents, une raison d’être, ceux qui empêchent de se laisser aller et pour qui la femme se doit de continuer à vivre. De nouvelles responsabilités ponctuent chaque journée : traire Bella (la vache), chasser le gibier qui peuple cette partie de nature, semer la terre de quelques pommes de terre et haricots laissés en provision pour l’hiver, faire fructifier la récolte, cueillir les baies, pêcher dans la rivière attenante – prévoir enfin pour chaque lendemain et pour la subsistance de chacun. Les saisons passent et la vie ressemble par certains côtés encore étrangement à celle d’auparavant ; elle est faite de naissance, de mort, de travail intense, d’espoir, de peine et de quelques joies.
Sorte de Robinson Crusoé féminin, la femme a peu de temps pour s’apitoyer sur son sort. L’effort précède la pensée et la survie est ce qui dicte le quotidien. Cependant la mort tragique du veau et surtout du chien, ce compagnon devenu si proche, la pousse à prendre la plume. Tous deux sont tués à coups de haches par un homme en folie, autre prisonnier des montagnes probablement, devenu au fil des ans aussi sauvage que le lieu et qui surgit soudain de nulle part. La femme raconte, elle écrit son « rapport » sur de vieux calendriers, sur tous les restes de papier épars, pour continuer le dialogue, ne pas perdre la raison, pour fixer notamment un temps qui s’échappe inexorablement, et cultive peut-être ainsi l’espoir vain et à demi conscient d’un possible lecteur.
Le film du même nom, réalisé par Julian Roman Pölsler en 2012, reprend avec fidélité la trame du livre de Hausfoher. Pendant près de deux heures le spectateur vit au rythme d’un personnage central, la femme, jouée par la remarquable Martina Gedeck, connue notamment pour Das Leben der Anderen (La vie des autres). Les animaux dont l’importance va grandissante ainsi que la nature toujours omniprésente constituent le reste de la distribution. Suspense et atmosphère fantastique maintiennent l’attention du spectateur, fasciné par l’étrangeté de l’histoire et la beauté sauvage des montagnes autrichiennes.
Extraordinaire, Gedeck incarne à merveille toutes les phases de son personnage, sa transformation, morale et physique. On la sent à la fois fragile et robuste, forte et faible, résignée et courageuse. Du silence monte la voix off de la femme qui écrit, accompagnée du bruit fait par le crayon sur le papier, puis de celui de ses pas craquants sur le plancher en bois lorsque fiévreuse elle se remémore son passé et essaie de donner un sens à l’insensée. L’utilisation de la musique est rare dans le film et les partitas de Bach sont réservées aux rares moments d’harmonie de la femme avec son environnement, à cette paix intérieure enfin atteinte lorsqu’elle arrive à fondre avec la nature. En revanche, près du mur, toujours là mais de moins en moins présent au fil de l’histoire, tous les sons s’arrêtent. Seul un léger sifflement électronique souligne l’absence de bruit ; il renforce l’idée de claustrophobie et d’inhumanité.
Les questions évoquées dans le roman sont nombreuses, elles déstabilisent. Doit-on y lire/voir le symbole d’un refuge ou une sorte de paradis de retour aux sources ou bien plutôt celui d’un enfermement dans la folie, dans l’enfer et l’apocalypse? Métaphore d’une femme à jamais coupée du monde et enfermée en elle-même ? Tentative de définition de la condition humaine ? Ultime leçon de courage ? Hymne à la vie ? Toute interprétation est permise et l’émotion ressentie par l’œuvre est intense.
On voit le film comme on lit le livre, avec lenteur et cependant complètement absorbés. La monotonie des tâches quotidiennes, le jour qui chasse la nuit, les pensées qui tournent en boucle, les saisons qui se répètent, rythment l’histoire, lui donne sa mesure et permettent au lecteur-spectateur d’entrer dans un temps hors du temps, une méditation profonde sur la vie.
Il est des films qui sont à la hauteur des livres qu’ils abordent, c’est le cas pour Die Wand, un livre et un film que je sais déjà vouloir revoir et relire.